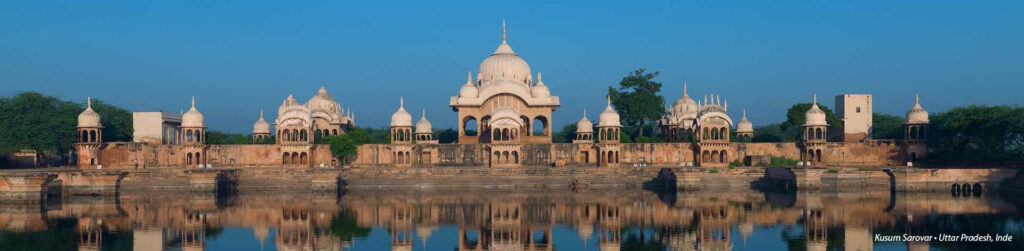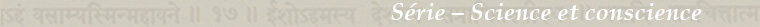

Suite de la série consacrée à l’exploration de la conscience, de sa nature, de son siège et de sa fonction, de même qu’à l’état des connaissances et à la perspective des Védas en la matière.
Voir le volet précédent.
Si la science n’a actuellement aucun moyen d’appréhender le phénomène de la conscience, c’est parce qu’elle ne s’intéresse qu’au monde objectif. Or, la conscience n’a rien à voir avec le monde objectif, entièrement composé d’éléments chimiques et physiques dénués de facultés perceptuelles et expérientielles. Il en découle que la conscience revêt un caractère subjectif, de sorte qu’il est communément admis que la notion même de conscience ne peut être évoquée dans aucun énoncé scientifique visant à décrire la réalité objective.
Comme on n’a aucune preuve observable et mesurable de l’existence d’une telle chose, ce que certains nomment «conscience» ne doit être que le fait d’un processus électrochimique propre au cerveau qui n’attend qu’une explication physique. C’est du moins ce que prétendent les scientifiques pour qui la perception consciente doit forcément s’opérer dans le cerveau.
Sauf que ces mêmes scientifiques s’entendent tous pour décrire le cerveau comme un assemblage de molécules échangeant des réactions chimiques sous l’effet d’impulsions électriques. Et aussi complexes que ces échanges puissent être, ils ne nous fournissent aucune information sur le caractère purement subjectif de nos perceptions et de la conscience que nous en avons.
Car, bien que tous les humains possèdent un cerveau construit de la même façon et fonctionnant de la même façon, suivant des mécanismes précis, clairement définis et uniformément invariables, leur perception et leur expérience du monde objectif et de leur propre existence varie considérablement d’un individu à un autre. Ce qui nous ramène au caractère subjectif de la conscience.
Subjectif, soit, mais non moins palpable et tout ce qu’il y a de plus réel. Personne ne saurait en effet nier qu’il est conscient de ses perceptions et de ses expériences, qu’il en a connaissance et qu’il les interprète en fonction de ses acquis, de ses dispositions et de ses humeurs. Le fait est que nous avons foncièrement conscience d’être conscients. Autrement dit, nous faisons directement l’expérience de la conscience en notre for intérieur.
Aux premières loges
Or, si la conscience existe mais que les connexions neuronales et les interactions biochimiques des molécules du cerveau ne permettent en rien d’établir un quelconque rapport entre les impulsions enregistrées dans notre boîte crânienne et nos perceptions ou expériences subjectives, comment la science peut-elle arriver à comprendre ce rapport?
Certains ont bien tenté d’approfondir la question dans l’espoir de trouver des réponses au niveau des particules atomiques et subatomiques dont se composent les molécules du cerveau, faisant en cela appel à la physique quantique. Mais cette dernière exprime et représente tous les phénomènes qu’elle étudie sous forme d’équations mathématiques réductibles à un ensemble de symboles objectifs et arbitraires qui ne fournissent aucune information sur notre expérience subjective de la perception, et donc sur la conscience. Pas plus que les combinaisons de 1 et de 0 à la base de tous les programmes d’ordinateur.
L’expérience la plus remarquable qu’il nous est donné de vivre n’en reste pas moins celle de pouvoir faire l’expérience de notre propre vie. Et cette capacité à faire l’expérience de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous sentons, de ce que nous touchons et de ce que nous éprouvons fait de nous des êtres en tous points différents de la matière physique, qui n’a aucune de ces facultés. Cette capacité fait de nous des êtres non seulement pensants, mais conscients d’être pensants, conscients de ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de nous, donc conscients non seulement de tout ce qui nous entoure, mais aussi de nos sensations, de nos pensées et de nos émotions.
Où se cache-t-elle donc?
La conscience n’appartient pas plus au règne de la matière inerte que l’expérience n’appartient au règne de l’inexpérience. Même s’il est vrai que nous ne pouvons pas nous fier de façon absolue à ce dont nous faisons l’expérience, puisque nos sens sont limités et que notre esprit n’est pas infaillible, nous n’en percevons pas moins que nous existons, et nos expériences ne nous appartiennent pas moins en propre.
Or, puisque nous vivons consciemment les expériences que nous vivons, si subjectives soient-elles, les êtres que nous sommes et la conscience que nous avons de ces expériences ne peuvent être de nature matérielle, ou physique, puisque la matière demeure strictement objective. La conscience que nous en avons nous donne en outre la possibilité d’agir sur le monde qui nous entoure et de le transformer, ce que la matière ne peut faire par elle-même dans la mesure où elle obéit de tout temps et en tout temps à des lois chimiques, physiques et cosmiques rigoureuses et inaltérables.
Tout bien considéré, puisque la notion de conscience demeure hypothétique aux yeux de la science actuelle, il peut être utile, pour mieux la comprendre, de s’interroger sur la nature de l’être qui en fait l’expérience. Les méthodes applicables à l’étude des phénomènes physiques n’étant d’aucun secours pour percer le mystère de la conscience et des dimensions subjectives de la réalité, il convient en effet d’envisager un élargissement du cadre d’analyse de la méthode scientifique.
À suivre...